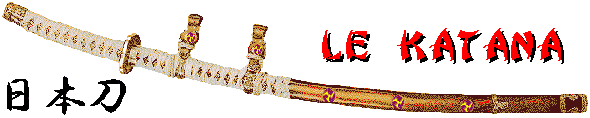
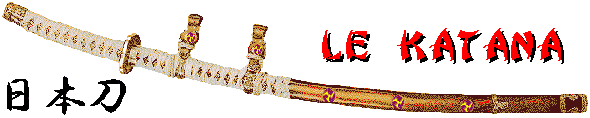
 En fonction
de l'époque, on dira qu'une lame est Koto (littéralement: ancien
sabre) si elle a été produite avant 1600; elle sera Shinto (littéralement
nouveau sabre) entre 1600 et 1800; après 1800, on dira qu'elle est Shinshinto
(littéralement nouveau nouveau sabre). En fonction
de l'époque, on dira qu'une lame est Koto (littéralement: ancien
sabre) si elle a été produite avant 1600; elle sera Shinto (littéralement
nouveau sabre) entre 1600 et 1800; après 1800, on dira qu'elle est Shinshinto
(littéralement nouveau nouveau sabre). En ce qui concerne la longueur,
on parlera de Tanto en dessous de 30cm, de Wakizashi entre
30 et 60cm et de Tachi ou de Katana au delà: les lames de
lance Yari et de Naginata sont à part. En ce qui concerne la longueur,
on parlera de Tanto en dessous de 30cm, de Wakizashi entre
30 et 60cm et de Tachi ou de Katana au delà: les lames de
lance Yari et de Naginata sont à part. Pour la forme des lames, on se réfèrera
au shéma qui donne les plus courantes. Il faut savoir que la majorité
des Katana et des Tachi sont de forme Shinogi Tsukuri; les Wakizashi
sont Shinogi Tsukuri ou Hira Tsukuri; les tanto sont le
plus souvent Hira Tsukuri, plus rarement Shobu ou Moroha Tsukuri.
Les naginata sont Kanmuri ou Unokubi Tsukuri (schéma ci-desous). Pour la forme des lames, on se réfèrera
au shéma qui donne les plus courantes. Il faut savoir que la majorité
des Katana et des Tachi sont de forme Shinogi Tsukuri; les Wakizashi
sont Shinogi Tsukuri ou Hira Tsukuri; les tanto sont le
plus souvent Hira Tsukuri, plus rarement Shobu ou Moroha Tsukuri.
Les naginata sont Kanmuri ou Unokubi Tsukuri (schéma ci-desous).  La lame Shinogi Tsukuri, la plus
courante, nous servira de base pour la description à suivre sur le shéma
ou le vocabulaire est détaille. L'expertise d'une lame japonaise passe
par l'examen d'un certain nombre de points: La lame Shinogi Tsukuri, la plus
courante, nous servira de base pour la description à suivre sur le shéma
ou le vocabulaire est détaille. L'expertise d'une lame japonaise passe
par l'examen d'un certain nombre de points: 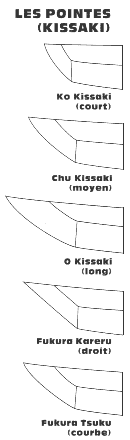
 En plus de l'analyse en 13 points retenus
au plan international, il convient d'examiner le Nakago, véritable
carte d'identité de la lame pour peu que celle-ci n'ait pas été raccourcie
(Suri Age), ou déteriorée. En plus de l'analyse en 13 points retenus
au plan international, il convient d'examiner le Nakago, véritable
carte d'identité de la lame pour peu que celle-ci n'ait pas été raccourcie
(Suri Age), ou déteriorée.Le Nagako a une forme variable: courbe, droit, effilé ou non, extrémité pointue ou arrondie; il peut caractériser l'époque ou l'école. L'examen de l'oxydation sur cette partie non polie de la lame peut donner des éléments de datation. Ne jamais décaper le Nakago. De même, son épaisseur par rapport à celle de la lame donne une idée du nombre de polissages subis, et, indirectement, de son âge. On rencontre encore l'orifice pour la goupille (Mejugi Ana), des traces de lime (Yasurime), qui caractérisent l'époque et l'origine de la lame. La face Omote de la lame peut porter la signature (Mei) du forgeron (La face Omote est celle qui se trouve à l'extérieur lorsque le sabre est porté à la ceinture). Toutes les lames ne sont pas signées, surtout les plus anciennes. Les signatures sont parfois fausses, soit que le forgeron ait délibérément produit un faux, soit qu'un marchand ait apposé une fausse signature pour valoriser la lame. La signature donne le nom du forgeron, souvent la province, voire le village d'origine, plus rarement le résultat de tests de coupe, l'origine du minerai, etc... Sur la face Ura (opposée à la face Omote) est inscrite parfois la date où la lame a été trempée.  L'examen de la lame se
termine par la recherche des défauts (Kizu). Les défauts d'origine
peuvent provenir d'un forgeage incorrect ou d'une trempe trop violente
qui fragilise la lame et induit des fêlures spontanées ou après usage.
Selon leur localisation et leur importance ils dévalorisent plus ou moins
la lame irrémédiablement. L'examen de la lame se
termine par la recherche des défauts (Kizu). Les défauts d'origine
peuvent provenir d'un forgeage incorrect ou d'une trempe trop violente
qui fragilise la lame et induit des fêlures spontanées ou après usage.
Selon leur localisation et leur importance ils dévalorisent plus ou moins
la lame irrémédiablement. |
Le katana , d'autres
ont fait 100 fois mieux que ce que j'aurai pu faire, alors voici un lien vers
un site dédié au sabre. A voir absolument!
![]()